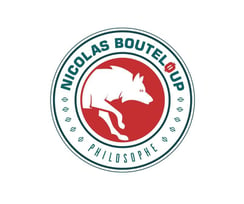Les liens qui libèrent : quand la philosophie éclaire nos relations humaines (1/3)
Comment distinguer les relations qui nous construisent de celles qui nous enchaînent ? Découvrez, avec Spinoza et la philosophie pratique, l'art de créer des liens authentiques qui libèrent.


Introduction
Cette année, j'ai eu l'occasion d'accompagner plusieurs organisations dans leurs réflexions sur le collectif et la cohésion d'équipe. À chaque fois, la même question revenait : comment créer des liens authentiques qui renforcent sans étouffer ? Comment distinguer les relations qui nous construisent et nous donnent de la force de celles qui nous enchaînent ?
Dans nos vies hyperconnectées et en accélération constante, comme dirait le sociologue Hartmut Rosa, où nous jonglons entre relations professionnelles, familiales, amicales et virtuelles, nous semblons paradoxalement de plus en plus isolés. J'ose le paradoxe : nous avons besoin de liens qui libèrent, et cela mérite bien que l'on fasse appel à la philosophie pratique ! C'est pour cette raison que j'ai intitulé mon livre Quand les liens nous libèrent. Les déclinaisons de l'ordre chez Spinoza (Hermann, 2024)
Il est fascinant de constater que nous utilisons le même mot – "lien" – pour désigner à la fois les chaînes qui nous entravent et les connexions qui nous épanouissent. Cette ambiguïté du langage révèle une vérité profonde : tout lien est potentiellement libérateur ou asservissant selon la manière dont nous l'habitons. Et peut-être est-ce justement dans les situations de contraintes et de nécessité que l'action libre prend tout son sens ?
Explorons ensemble cette métaphysique des relations humaines pour comprendre comment tisser des liens qui libèrent vraiment.
1. Cartographie des liens humains : comprendre la diversité de nos connexions
Avez-vous déjà remarqué combien il est difficile de définir précisément ce qui nous lie aux autres ? Quand on creuse un peu, on découvre que nos liens humains se déclinent selon plusieurs dimensions qui s'entremêlent de manière fascinante.
Les liens biologiques : héritage et liberté
Les liens biologiques nous rattachent à notre héritage génétique, créant des connexions qui nous précèdent et nous survivront. Dans notre ADN se dissimule en puissance un patrimoine génétique qui nous dépasse et nous impose des conditions d'existence. On ne choisit pas cet héritage, mais l'on peut choisir ce qu'on en fait et à quel point nous lui donnons de la force.
Dans le film d'Andrew Niccol, Bienvenue à Gattaca (1997), qui décrit une société dystopique futuriste dans laquelle les familles riches peuvent choisir les caractères génétiques de leurs enfants, un enfant "né du hasard" et qui est conditionné, par ses gènes, à certaines prédispositions et maladies, décide de lutter et se faire passer pour un autre afin de se libérer et atteindre ses rêves de partir dans l'espace.
D'ailleurs, le lien biologique n'est pas un lien choisi ! Combien de personnes se sentent-elles plus proches de leur "famille choisie" – ces amis qui deviennent frères et sœurs – que de leur famille de sang ? On sait maintenant depuis de longues années que ce qui crée la famille est bien autre chose qu'un lien de filiation biologique.
Les liens sociaux : communauté et appartenance
Les liens sociaux nous inscrivent dans des communautés : notre famille, notre quartier, notre entreprise, notre club de sport. Ces liens peuvent être subis (on n'a pas choisi ses collègues) ou recherchés (on adhère à une association). Là encore, tout dépend de la manière dont nous les habitons.
Chaque lien social s'insère au cœur d'un réseau complexe socio-culturel. Comme le dit Spinoza dans son Éthique, faire communauté est avant tout trouver ce qui est commun au cœur des individus. Pour le philosophe d'Amsterdam, toute chose possède du commun les unes avec les autres, et ce qui crée une communauté est de justement se concentrer sur ce qui nous relie plutôt que ce qui nous oppose.
Les liens affectifs : l'art de la rencontre émotionnelle
Les liens affectifs naissent de la rencontre entre deux subjectivités qui se reconnaissent et s'apprécient. L'amitié, l'amour, la complicité parentale... Ces liens semblent les plus évidents, mais ils sont aussi les plus mystérieux dans leur genèse.
Comme le dit très bien le philosophe Bergson (1859-1941), quand il est question d'émotion, nous manquons toujours de mots, et chercher à décrire nos affects par le langage nous fait forcément rater l'expérience émotionnelle. Une émotion se vit et se partage avant de s'exprimer en mots ou en images.
Le concept d'amour est un bon exemple de ce trouble. Dans la langue française, ce terme recouvre des réalités extrêmement différentes. Dans la Grèce Antique, on utilisait par exemple :
Éros pour la passion et le désir charnel
Storgè pour l'affection familiale protectrice
Philia pour l'amitié profonde et le respect mutuel
Agapè pour l'amour altruiste et désintéressé
Ça fait une belle diversité !
Les liens spirituels : connexions transcendantes
Les liens spirituels ou philosophiques nous connectent à quelque chose qui nous dépasse : une vision du monde, des valeurs partagées, une quête de sens commune. C'est ce qu'on ressent parfois en discutant avec un inconnu dans un café et en découvrant qu'on partage la même vision de la justice ou de la beauté.
Quand cette discussion semble unir plusieurs personnes dans un même dialogue, à trouver ensemble un accord sur leur compréhension de ce qui les entoure, cela crée une forme de relation très belle et puissante, qui peut modifier notre expérience du monde. C'est, je crois, ce qui se loge dans ce que Spinoza (1632-1677) appelle la "science intuitive", qu'il considère comme le 3e genre de connaissance, et nous conduit vers le bonheur et la liberté.
Le paradoxe de la différence dans l'unité
Mais voici ce qui est troublant : ce qui nous unit n'est pas forcément ce qui nous ressemble. C'est comme s'il fallait un peu de commun entre nous pour nous entendre, mais suffisamment de différence pour nous compléter et nous grandir.
Paradoxalement, nos liens les plus riches naissent souvent de nos différences. L'ami qui nous apporte un regard neuf, le collègue qui complète nos compétences, le partenaire qui équilibre notre tempérament... C'est cette tension entre similarité et altérité qui donne sa richesse à nos relations.
2. La métaphysique du lien : liberté ou servitude ?
Pourquoi certaines relations nous donnent-elles des ailes tandis que d'autres nous clouent au sol ? Cette question nous emmène au cœur d'une distinction philosophique fondamentale.
Spinoza et la théorie des affects : augmenter ou diminuer notre puissance
Spinoza (1632-1677) nous offre une grille de lecture particulièrement éclairante avec sa théorie des affects. Pour lui, chaque rencontre augmente ou diminue notre "puissance d'agir", ce qu'il nomme conatus ("effort") en latin.
Les liens qui libèrent sont ceux qui nous rendent plus capables, plus créatifs, plus confiants. Ces liens sont avant tout ceux qui sont conduits par la raison et la compréhension.
Les liens qui asservissent nous diminuent, nous fragilisent, nous limitent.
Applications concrètes : l'exemple du management
Prenons l'exemple du management. Un manager qui fait confiance à son équipe, qui délègue et encourage l'initiative, crée des liens qui libèrent : chaque collaborateur se sent valorisé et développe ses compétences. À l'inverse, un manager qui contrôle tout, critique constamment et maintient ses équipes dans la dépendance, tisse des liens qui asservissent.
Citoyen versus sujet : une distinction éclairante
Dans son Traité Politique (chapitre III), Spinoza propose une distinction que je trouve très parlante. Il fait la différence entre le sujet et le citoyen :
"Nous appelons "citoyens" les hommes en tant qu'ils jouissent selon le droit civil de tous les avantages de la Cité, et nous les appelons "sujets" en tant qu'ils sont tenus de se soumettre aux institutions et aux lois de la Cité."
Selon cette interprétation, les citoyens et les sujets ne sont pas deux catégories d'individus, mais deux manières de se rapporter au droit et à la Cité. Celui qui ne cherche qu'à subir les lois reste simplement Sujet, alors que le Citoyen cherche à comprendre et à agir dans la Cité en accord avec ces lois qu'il comprend.
Codépendance versus interdépendance : la distinction cruciale
La codépendance vs l'interdépendance : voilà peut-être la distinction la plus cruciale de notre époque.
La codépendance, c'est quand nous avons besoin de l'autre pour exister, quand nous perdons notre identité dans la relation. "Je ne suis rien sans toi", dit la chanson, mais c'est précisément le piège !
L'interdépendance, c'est reconnaître que nous nous enrichissons mutuellement tout en gardant notre autonomie. "Je suis moi avec toi", pourrait-on dire.
Les relations symbiotiques que l'on trouve dans la nature en sont de parfaits témoignages, comme le poisson clown et l'anémone.
La contrainte choisie comme paradoxe libérateur
Mais attention à ne pas tomber dans la naïveté ! Certains liens impliquent nécessairement des contraintes, et c'est même ce qui fait leur valeur. Que l'on soit ou non partisan de la monogamie, l'engagement amoureux limite ma liberté de séduction et singularise une relation...
Quand ces contraintes sont choisies, consenties et équilibrées, elles deviennent paradoxalement libératrices car elles nous permettent de construire quelque chose de plus grand que nous. Je ne peux pas m'empêcher de penser ici au mouvement artistique Oulipo, qui défendait magistralement comment la contrainte était un terreau particulièrement fertile pour la création artistique.
Imagination et raison : une interdépendance féconde
Dans le Traité Théologico-politique, Spinoza propose de distinguer entre l'imagination et la raison. L'imagination est une puissance extrêmement vive de création de lien. Elle est créatrice de métaphores, d'analogies, et permet de lier toutes les idées les unes avec les autres, dans tous les sens possibles et imaginables.
La raison, quant à elle, est plus "limitée" car elle ne peut que relier et organiser les idées dans un sens qui soit cohérent et intelligible. Cette limitation est tout de même une force, si l'on cherche à accéder à la vérité, mais elle peut être une faiblesse, si l'on cherche à produire des réseaux d'idées.
C'est pourquoi Spinoza suggère que la raison fasse toujours appel à l'imagination de manière raisonnable, pour faciliter l'apprentissage et la compréhension. Une interdépendance au sein de notre esprit.
3. Les limites du lien : peut-on tout relier ?
Cette question m'intrigue depuis longtemps : y a-t-il des limites à notre capacité de créer des liens ? Et si oui, comment les identifier ?
Le nombre de Dunbar : nos limites cognitives
L'anthropologue Robin Dunbar a montré que nous ne pouvons maintenir qu'environ 150 relations sociales stables, avec des cercles plus restreints : 5 liens intimes, 15 liens proches, 50 liens significatifs. Ces limites cognitives, que l'on appelle maintenant "le nombre de Dunbar", ne sont pas des fatalités, mais elles nous invitent à réfléchir à la qualité plutôt qu'à la quantité.
Sur LinkedIn, j'ai 2000 "connexions", mais combien sont des relations vraiment fertiles ? À l'ère des réseaux sociaux, nous confondons souvent connexion et lien. Se connecter, c'est instantané et superficiel. Se lier, c'est progressif et profond. Cette différence mérite qu'on s'y arrête, et ce sera l'objet d'un article prochain.
Les liens inter-espèces : au-delà de l'humain
Peut-on se lier avec ce qui est d'une autre nature que nous ? Cette question m'a longtemps fasciné. Pour Spinoza, nous ne pouvons nous relier qu'avec ce qui est de même nature et qui partage du commun avec nous. Mais qu'est-ce que ma nature, et en quoi est-elle différente ou identique de ce qui m'entoure ?
Nos relations aux animaux domestiques montrent que oui, nous pouvons créer des liens inter-espèces authentiques. Les jardiniers développent souvent une relation intime avec leurs plantes. Les artisans parlent de leur "dialogue" avec la matière...
Ces expériences suggèrent que la capacité de lien dépasse les frontières de l'espèce humaine. Peut-être même pouvons-nous nous lier au temps (à travers les traditions), à l'espace (à travers notre attachement aux lieux), aux idées (à travers nos engagements intellectuels).
Tout ce qui existe dans la nature et dans le cosmos est peut-être lié dans une même trame invisible ? Serait-ce ce que Spinoza appelait justement "Dieu ou la Nature" ?
L'écologie des relations : vers une conscience élargie
La question écologique ouvre des perspectives vertigineuses. Baptiste Morizot, dans ses "Manières d'être vivant", nous invite à considérer nos interdépendances avec l'ensemble du vivant. Nous sommes reliés aux forêts qui produisent notre oxygène, aux sols qui nourrissent nos aliments, aux océans qui régulent le climat...
Prendre conscience de ces liens invisibles mais vitaux transforme notre rapport au monde.
Les limites éthiques : savoir rompre pour mieux lier
Mais il y a aussi des limites éthiques au lien. On ne peut pas se lier avec ce qui nous nie ou nous détruit. Certaines idéologies, certains systèmes d'oppression, certaines personnes toxiques dépassent les seuils de la relation saine.
Savoir dire non, savoir rompre, savoir délier fait aussi partie de l'art de tisser des liens qui libèrent. Les ruptures, dont parle notamment Claire Marin dans son ouvrage, sont aussi importantes à l'existence que les liens.
Avoir le courage de rompre les liens, d'agir en accord avec ses valeurs plutôt qu'avec la pression de l'extérieur, c'est aussi là que réside notre liberté.
Conclusion : L'art de tisser des liens libérateurs
Au terme de cette exploration, une conviction se dessine : les liens qui libèrent ne tombent pas du ciel. Ils se cultivent consciemment, avec discernement et patience.
Trois piliers pour des relations libératrices
Ils exigent d'abord la connaissance de soi : comprendre nos besoins, nos limites, nos patterns relationnels. Comment pourrions-nous tisser des liens sains si nous ne savons pas qui nous sommes et ce qui nous fait du bien ?
Ils demandent ensuite le respect de l'altérité : accepter que l'autre soit différent, qu'il ait son propre chemin, ses propres rythmes. Les liens qui libèrent ne cherchent pas à formater l'autre à notre image.
Ils supposent enfin l'acceptation de l'impermanence : nos liens évoluent, se transforment, parfois se défont. Plutôt que de s'accrocher à des formes figées, mieux vaut accompagner leurs métamorphoses.
Vers une écologie des relations
Cette réflexion sur les liens qui libèrent nous ouvre vers d'autres questions passionnantes. Comment recréer du lien dans une société fragmentée ? Comment distinguer connexion numérique et relation authentique ? Comment développer une véritable écologie des relations ?
Autant de pistes que nous explorerons dans les prochains articles de cette série. Car comprendre la métaphysique des liens n'est qu'un début : reste maintenant à apprendre l'art de les tisser au quotidien.
Un exercice pratique pour commencer
En attendant, je vous propose un petit exercice : observez vos relations de ces derniers jours. Lesquelles vous ont donné de l'énergie ? Lesquelles vous en ont pris ? Quels sont les liens qui vous libèrent vraiment ?
Peut-être est-ce là les premières graines qui transformeront votre existence…
Merci pour votre lecture et votre attention !
Vous souhaitez explorer ces questions dans le cadre de votre organisation ? Mes interventions philosophiques aident les équipes à créer des liens authentiques qui renforcent la cohésion sans étouffer l'individualité. Découvrez mes accompagnements en entreprise ou contactez-moi pour échanger sur vos besoins spécifiques.